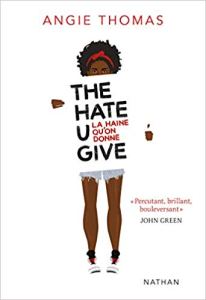 – Après tout ce que je viens de te dire, continue-t-il, en quoi cette Thug Life s’applique aux manifs et aux émeutes ?
– Après tout ce que je viens de te dire, continue-t-il, en quoi cette Thug Life s’applique aux manifs et aux émeutes ?
Je prends une minutes pour réfléchir.
– Tout le monde est vénère parce que Cent-Quinze a pas été inculpé, je dis. Mais aussi parce qu’il est pas le premier à agir comme ça et à s’en sortir. Ça arrive régulièrement et les gens continueront à se révolter jusqu’à ce que ça change. Donc je crois que le système nous en balance en permanence, de la haine. Et au bout du compte, tout le monde se fait niquer.
Papa se met à rire et me tape dans la paume.
– Ouais, bien ! Fais gaffe à ton vocabulaire, mais c’est à peu près ça. Et on continuera à se faire niquer jusqu’à ce que ça change. Parce que la clé c’est ça : faut que ça change.
Je réalise peu à peu – violemment – à quel point tout ça est vrai et une boule se forme dans ma gorge.
– C’est pour ça que les gens ouvrent leur gueule, hein ? Parce que rien ne changera si on ne dit rien.
– C’est ça. On ne peut pas se taire.
– Alors moi non plus.
Nathan, pages 191-192
Starr a seize ans. Elle est noire et vit dans un quartier qui est le théâtre d’une véritable guerre des gangs. Tous les jours, elle va dans un lycée privé et doit jongler avec ses différentes personnalités : la noire au milieu des blanc.he.s, celle qui doit éviter d’être « trop » pour rester cool – trop fragile, trop en colère, trop visible, trop noire finalement –, et la Starr qui n’oublie pas d’où elle vient, ou à qui on le rappelle. Cet équilibre on ne peut plus précaire se trouve rompu lorsqu’un soir elle voit son ami Khalil se faire tuer par un policier. Elle est la seule témoin. Entre peur, horreur et rage, se pose pour elle la question de la nécessité, ou non, de la parole et de l’action.
J’ai été très agréablement surprise par cette lecture. Après en avoir entendu beaucoup parlé, j’avais peur que ce soit bourré de bons sentiments. A priori injustifié apparemment. Car Angie Thomas a une écriture fluide qui nourrit autant l’émotion que la colère. Elle aborde un grand nombre de sujets et parvient à donner vie à des sentiments vibrants et une réelle réflexion. The Hate U Give est un roman qui donne la voix à un propos politique. J’ai aimé comment la lucidité sur la difficulté, voire l’impossibilité, du combat n’entame pas la conviction.
L’assassinat de George Floyd et les manifestations contre le racisme et les violences policières, suite notamment à la mort d’Adama Traoré – pour ne parler que de ce qui très récemment a eu de l’espace médiatique –, donnent encore plus de résonance à cette lecture. Quoique, le problème étant profondément systémique, il y a fort à parier que le propos est depuis longtemps d’actualité, et risque malheureusement de le rester.
Un livre que j’aurais envie de mettre entre bien des mains pour m’épargner la fatigue de débats sans fin, une fiction au service de la lutte, où le racisme n’a pas de droit de réponse.
Découvrez aussi Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie et Nous les filles de nulle part d’Amy Reed.
Écoutez les premières pages !
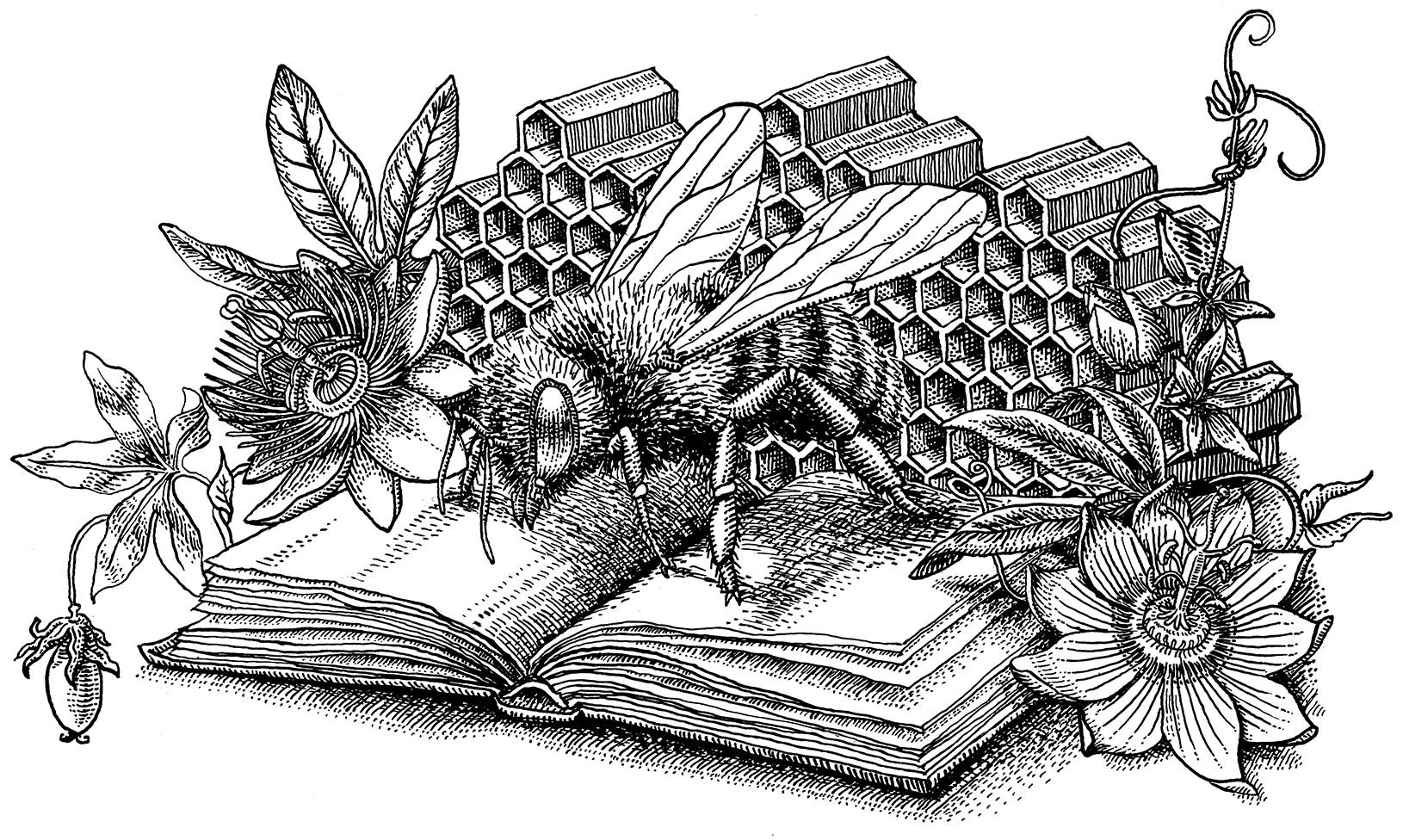
 L’obscurité s’installe et la température descend de plusieurs degrés. Nous faisons ensuite halte dans une cuvette. Épuisé, je m’enveloppe dans mon manteau en peau de bison et me blottis contre le ventre chaud de Tami. Quand je n’ai plus froid, je lève les yeux vers le ciel. Mes prunelles se remplissent d’étoiles et j’ai soudain la sensation de prendre un bain dans l’éternité.
L’obscurité s’installe et la température descend de plusieurs degrés. Nous faisons ensuite halte dans une cuvette. Épuisé, je m’enveloppe dans mon manteau en peau de bison et me blottis contre le ventre chaud de Tami. Quand je n’ai plus froid, je lève les yeux vers le ciel. Mes prunelles se remplissent d’étoiles et j’ai soudain la sensation de prendre un bain dans l’éternité.  Yogi s’excusa d’un geste de la main. Dans ma tête, je procédai à une analyse rapide des événements. Pour l’instant, je ne m’étais pas encore fourré dans une situation gênante et inextricable. Ma seule décision jusqu’-là avait été de repousser mon vol retour, et de partir seulement après Holî. Ensuite je laissais au temps et aux circonstances le soin de décider de la prochaine étape. Tout ça était nouveau pour moi, qui avais l’habitude de tout planifier dans les moindres détails. Et c’était surtout libérateur.
Yogi s’excusa d’un geste de la main. Dans ma tête, je procédai à une analyse rapide des événements. Pour l’instant, je ne m’étais pas encore fourré dans une situation gênante et inextricable. Ma seule décision jusqu’-là avait été de repousser mon vol retour, et de partir seulement après Holî. Ensuite je laissais au temps et aux circonstances le soin de décider de la prochaine étape. Tout ça était nouveau pour moi, qui avais l’habitude de tout planifier dans les moindres détails. Et c’était surtout libérateur. 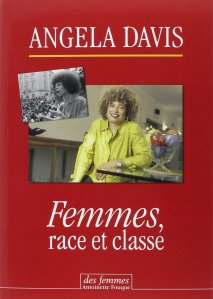 Il y avait beaucoup de naïveté politique dans son analyse des derniers moments de la guerre ; elle se montrait plus vulnérable que jamais à l’idéologie raciste. Dès que l’armée unioniste eut triomphé de ses opposants confédérés, Elizabeth Stanton et ses collègues exigèrent du Parti républicain une récompense pour les efforts accomplis pendant la guerre : elles réclamaient le droit de vote, comme si un traité avait été conclu ; comme si les féministes avaient lutté contre l’esclavage en visant ce droit.
Il y avait beaucoup de naïveté politique dans son analyse des derniers moments de la guerre ; elle se montrait plus vulnérable que jamais à l’idéologie raciste. Dès que l’armée unioniste eut triomphé de ses opposants confédérés, Elizabeth Stanton et ses collègues exigèrent du Parti républicain une récompense pour les efforts accomplis pendant la guerre : elles réclamaient le droit de vote, comme si un traité avait été conclu ; comme si les féministes avaient lutté contre l’esclavage en visant ce droit.  Même lorsque l’agresseur sexuel reconnaît qu’il a commis les actes qui lui sont reprochés, il met encore une forme de distanciation face aux gestes qu’il a pu faire. Certes, il les a bien commis, certes, dans d’autres contextes cela serait un viol ou une agression sexuelle, mais dans son cas précis, cela n’a strictement rien à voir. On les verra alors parler de « dérapage », « d’humour un peu lourd », de « culture tactile », de « problèmes personnels » ou de « choses qui tournent mal ».
Même lorsque l’agresseur sexuel reconnaît qu’il a commis les actes qui lui sont reprochés, il met encore une forme de distanciation face aux gestes qu’il a pu faire. Certes, il les a bien commis, certes, dans d’autres contextes cela serait un viol ou une agression sexuelle, mais dans son cas précis, cela n’a strictement rien à voir. On les verra alors parler de « dérapage », « d’humour un peu lourd », de « culture tactile », de « problèmes personnels » ou de « choses qui tournent mal ».  Ce sont mes dernières minutes de liberté. Du coin de l’œil, je vois Roussel qui relève la tête. Il va bientôt sonner la fin des hostilités. Il va ajouter que ce n’est pas grave si on n’a pas terminé, qu’on pourra finir à la maison. Ou pas. Que l’important, c’est de se plier aux exigences dans un temps limité, et “de dévider nos pelotes internes”. C’est l’expression qu’il a utilisée la dernière fois. Je l’ai trouvée racoleuse et même malsaine. Ensuite, il va demander qu’on lise à haute voix ce qu’on a produit. Tant pis pour les maladresses, la syntaxe approximative ou les erreurs de grammaire. S’exprimer. On est là pour s’exprimer. Il n’y aura aucun jugement ni aucune correction, puisque ce n’est pas le but. On va faire un tour de table. On arrivera à moi. Et je serai démasqué. Je suis hors sujet. Je ne lirai pas les trois pages que je viens de couvrir. Je me souviens que l’an dernier j’avais cherché sur internet la définition de l’expression “toute honte bue”.
Ce sont mes dernières minutes de liberté. Du coin de l’œil, je vois Roussel qui relève la tête. Il va bientôt sonner la fin des hostilités. Il va ajouter que ce n’est pas grave si on n’a pas terminé, qu’on pourra finir à la maison. Ou pas. Que l’important, c’est de se plier aux exigences dans un temps limité, et “de dévider nos pelotes internes”. C’est l’expression qu’il a utilisée la dernière fois. Je l’ai trouvée racoleuse et même malsaine. Ensuite, il va demander qu’on lise à haute voix ce qu’on a produit. Tant pis pour les maladresses, la syntaxe approximative ou les erreurs de grammaire. S’exprimer. On est là pour s’exprimer. Il n’y aura aucun jugement ni aucune correction, puisque ce n’est pas le but. On va faire un tour de table. On arrivera à moi. Et je serai démasqué. Je suis hors sujet. Je ne lirai pas les trois pages que je viens de couvrir. Je me souviens que l’an dernier j’avais cherché sur internet la définition de l’expression “toute honte bue”.  Quelqu’un, quelque part, disait de faire attention au fil.
Quelqu’un, quelque part, disait de faire attention au fil. 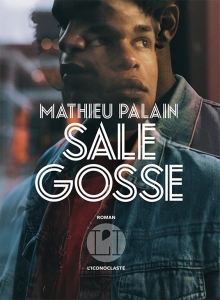 – Quand je suis arrivé à la PJJ, je voulais changer le monde. Aujourd’hui, j’essaye de ne pas l’abîmer. Ton métier, c’est semer sans jamais récolter. Tu suis des mêmes qui disparaissent dans la nature, d’autres les remplacent et tu dois te remettre à semer. Ce n’est pas pour les pragmatiques qui veulent des résultats.
– Quand je suis arrivé à la PJJ, je voulais changer le monde. Aujourd’hui, j’essaye de ne pas l’abîmer. Ton métier, c’est semer sans jamais récolter. Tu suis des mêmes qui disparaissent dans la nature, d’autres les remplacent et tu dois te remettre à semer. Ce n’est pas pour les pragmatiques qui veulent des résultats. 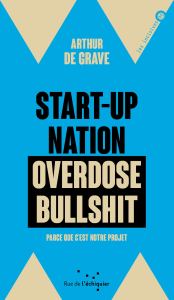 Est-ce à dire qu’il n’y a rien à apprendre de toutes ces belles success-stories ? Non, bien sûr. Mais à condition de ne pas tout mélanger… Par exemple, quand j’entends un quelconque ministre de l’Économie s’extasier sur ces start-up qui créeront demain de l’emploi en masse, j’ai envie de me resservir deux fois des nouilles. Parce que, mon bon ami, pour revenir à une situation de plein-emploi avec les start-up comme pierre angulaire de ta stratégie, il va falloir te lever très, mais alors très tôt. Le but d’une start-up, ce n’est pas de « créer des emplois », n’en déplaise à la novlangue lénifiante que tu aimes tant à employer. C’est même tout le contraire ! Le but d’une start-up, c’est l’hypercroissance, c’est de scaler : faire exploser son volume d’affaires en maintenant les coûts au plus bas pour assurer à terme un très haut niveau de rentabilité. Je ne dis pas que c’est bien ou mal, mais qu’une start-up, par définition, c’est ça. C’est un effet de structure. On n’y peut rien : créer des emplois stables et bien payés en masse, cela entre en contradiction directe avec cet impératif de « scalabilité » (le terme est barbare, je sais, mais c’est la lingua franca de la Start-up Nation, je n’y peux rien).
Est-ce à dire qu’il n’y a rien à apprendre de toutes ces belles success-stories ? Non, bien sûr. Mais à condition de ne pas tout mélanger… Par exemple, quand j’entends un quelconque ministre de l’Économie s’extasier sur ces start-up qui créeront demain de l’emploi en masse, j’ai envie de me resservir deux fois des nouilles. Parce que, mon bon ami, pour revenir à une situation de plein-emploi avec les start-up comme pierre angulaire de ta stratégie, il va falloir te lever très, mais alors très tôt. Le but d’une start-up, ce n’est pas de « créer des emplois », n’en déplaise à la novlangue lénifiante que tu aimes tant à employer. C’est même tout le contraire ! Le but d’une start-up, c’est l’hypercroissance, c’est de scaler : faire exploser son volume d’affaires en maintenant les coûts au plus bas pour assurer à terme un très haut niveau de rentabilité. Je ne dis pas que c’est bien ou mal, mais qu’une start-up, par définition, c’est ça. C’est un effet de structure. On n’y peut rien : créer des emplois stables et bien payés en masse, cela entre en contradiction directe avec cet impératif de « scalabilité » (le terme est barbare, je sais, mais c’est la lingua franca de la Start-up Nation, je n’y peux rien). 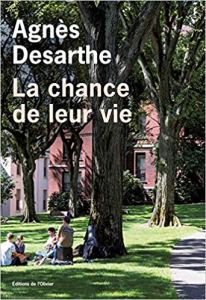 Hector s’est chargé de tout. Il a plié de nouveau tous les pulls que Sophie avait pliés, mais al/ Sans remarques désagréables, sans se moquer ni se plaindre. Sylvie l’a regardé faire, reconnaissante, tout en ayant l’impression qu’on lui sciait doucement les poignets. Les jours s’empilent. Pourtant le quotidien semble ne pas se construire ; l’habitude et sa prodigieuse force d’inertie sont absentes. Certains matins, Sylvie se demande si elle existe encore et, juste après, ce que cela signifie d’exister. Elle sent alors, sous ses pas, le rebord d’une spirale d’anxiété. Si elle avance sur cette voie, elle sera fichue. Elle glissera, perdra ses moyens, ne saura plus remonter. Cela lui est arrivé autrefois. Elle se rappelle la sensation. Un anéantissement auquel on assiste en spectateur, jusqu’au moment où l’on se rend compte que l’on est soi-même démoli. On est alors saisi par l’effroi et l’envie de fuir, sauf que l’on n’a plus l’énergie nécessaire pour s’échapper, faire marche arrière. L’énergie, elle aussi a été détruite, absorbée. Mais c’est très différent à présent. Elle est simplement dépaysée. Hector lui parle de repères. Il lui conseille de prendre ses marques, de s’inventer une routine et, assez rapidement, tout s’améliore. Lester se rend au collège avec le bus jaune. Il est plein de vigueur. Il semble avoir grandi d’un ou deux centimètres. Sylvie a étudié les brochures rapportées quelques semaines plus tôt de l’Alliance française. Cours de danse, de tai-chi, de langues, soirées lecture, spectacles pour enfants, semaine gastronomique. Combien de temps vont-ils rester ? Cela vaut-il la peine qu’elle s’inscrive à toutes ces activités ? N’en choisir qu’une. Atelier de poterie, le mardi et le jeudi. Hector la félicite. Il lui confirme que l’important, c’est de structurer sa semaine.
Hector s’est chargé de tout. Il a plié de nouveau tous les pulls que Sophie avait pliés, mais al/ Sans remarques désagréables, sans se moquer ni se plaindre. Sylvie l’a regardé faire, reconnaissante, tout en ayant l’impression qu’on lui sciait doucement les poignets. Les jours s’empilent. Pourtant le quotidien semble ne pas se construire ; l’habitude et sa prodigieuse force d’inertie sont absentes. Certains matins, Sylvie se demande si elle existe encore et, juste après, ce que cela signifie d’exister. Elle sent alors, sous ses pas, le rebord d’une spirale d’anxiété. Si elle avance sur cette voie, elle sera fichue. Elle glissera, perdra ses moyens, ne saura plus remonter. Cela lui est arrivé autrefois. Elle se rappelle la sensation. Un anéantissement auquel on assiste en spectateur, jusqu’au moment où l’on se rend compte que l’on est soi-même démoli. On est alors saisi par l’effroi et l’envie de fuir, sauf que l’on n’a plus l’énergie nécessaire pour s’échapper, faire marche arrière. L’énergie, elle aussi a été détruite, absorbée. Mais c’est très différent à présent. Elle est simplement dépaysée. Hector lui parle de repères. Il lui conseille de prendre ses marques, de s’inventer une routine et, assez rapidement, tout s’améliore. Lester se rend au collège avec le bus jaune. Il est plein de vigueur. Il semble avoir grandi d’un ou deux centimètres. Sylvie a étudié les brochures rapportées quelques semaines plus tôt de l’Alliance française. Cours de danse, de tai-chi, de langues, soirées lecture, spectacles pour enfants, semaine gastronomique. Combien de temps vont-ils rester ? Cela vaut-il la peine qu’elle s’inscrive à toutes ces activités ? N’en choisir qu’une. Atelier de poterie, le mardi et le jeudi. Hector la félicite. Il lui confirme que l’important, c’est de structurer sa semaine.