 L’obscurité s’installe et la température descend de plusieurs degrés. Nous faisons ensuite halte dans une cuvette. Épuisé, je m’enveloppe dans mon manteau en peau de bison et me blottis contre le ventre chaud de Tami. Quand je n’ai plus froid, je lève les yeux vers le ciel. Mes prunelles se remplissent d’étoiles et j’ai soudain la sensation de prendre un bain dans l’éternité.
L’obscurité s’installe et la température descend de plusieurs degrés. Nous faisons ensuite halte dans une cuvette. Épuisé, je m’enveloppe dans mon manteau en peau de bison et me blottis contre le ventre chaud de Tami. Quand je n’ai plus froid, je lève les yeux vers le ciel. Mes prunelles se remplissent d’étoiles et j’ai soudain la sensation de prendre un bain dans l’éternité.
Traçant des traits imaginaires d’une étoile à une autre, je pense à mon père, à mon frère, à ma grand-mère, à ma mère… Bientôt, tous ces traits forment deux losanges distincts, comme deux yeux qui me regardent fixement.
Je grogne.
Pour le moment, je ne veux plus penser à ma mère.
Thierry Magnier, pages 106-107
1860, les grandes plaines américaines sont peu à peu ratissées par les colons qui, sur leur passage, tuent ou parquent les Indiens, et laissent une terre souvent désolée. Quanah Parker est métisse. Il est le fils du grand chef Peta Nocona et d’une blanche. Lorsque le premier est assassiné au cours d’une attaque et que la seconde se rend, il chevauche avec son petit frère pour retrouver leur tribu. Mais leurs yeux clairs les rendent suspects auprès de celleux qui étaient les leurs auparavant. Quanah reprend donc sa chevauchée à travers ce territoire immense qui ne devrait appartenir à personne. Des années durant, il lutte, aime et construit, mais la marche de l’Histoire ne laisse ici aucun doute : il sera le dernier chef comanche libre.
Inspiré de faits réels, ce roman nous emporte dans la poésie des espaces immenses et arides où les existences trouvent leur équilibre entre nature, spiritualité, culture et communauté. Nathalie Bernard a effectué un travail conséquent de recherche pour constituer ce texte qui nous emporte dans une logique de vie absolument étrangère à nos yeux d’Européen.ne.s du XXIe siècle, et qui néanmoins nous saisit. J’ai retrouvé la fascination que petite je ressentais face à Danse avec les loups, la colère en supplément. Une histoire vieille de 160 ans et qui toutefois entre en résonance parfaite avec les logiques économiques impérialistes et consuméristes contemporaines. C’est affolant.
Et pourtant, malgré la fin, persiste une lueur d’espoir. Car même si elle risque constamment d’être brimée, la liberté qui se dégage de ces pages est d’une force vibrante. Alors, on a envie de lire et de faire un.e avec notre mustang (celui qu’on a dans la tête à tout le moins) pour continuer à galoper.
Découvrez aussi Sans foi ni loi de Marion Brunet et Le Gang de la clef à molette d’Edward Abbey.
Écoutez les premières pages !
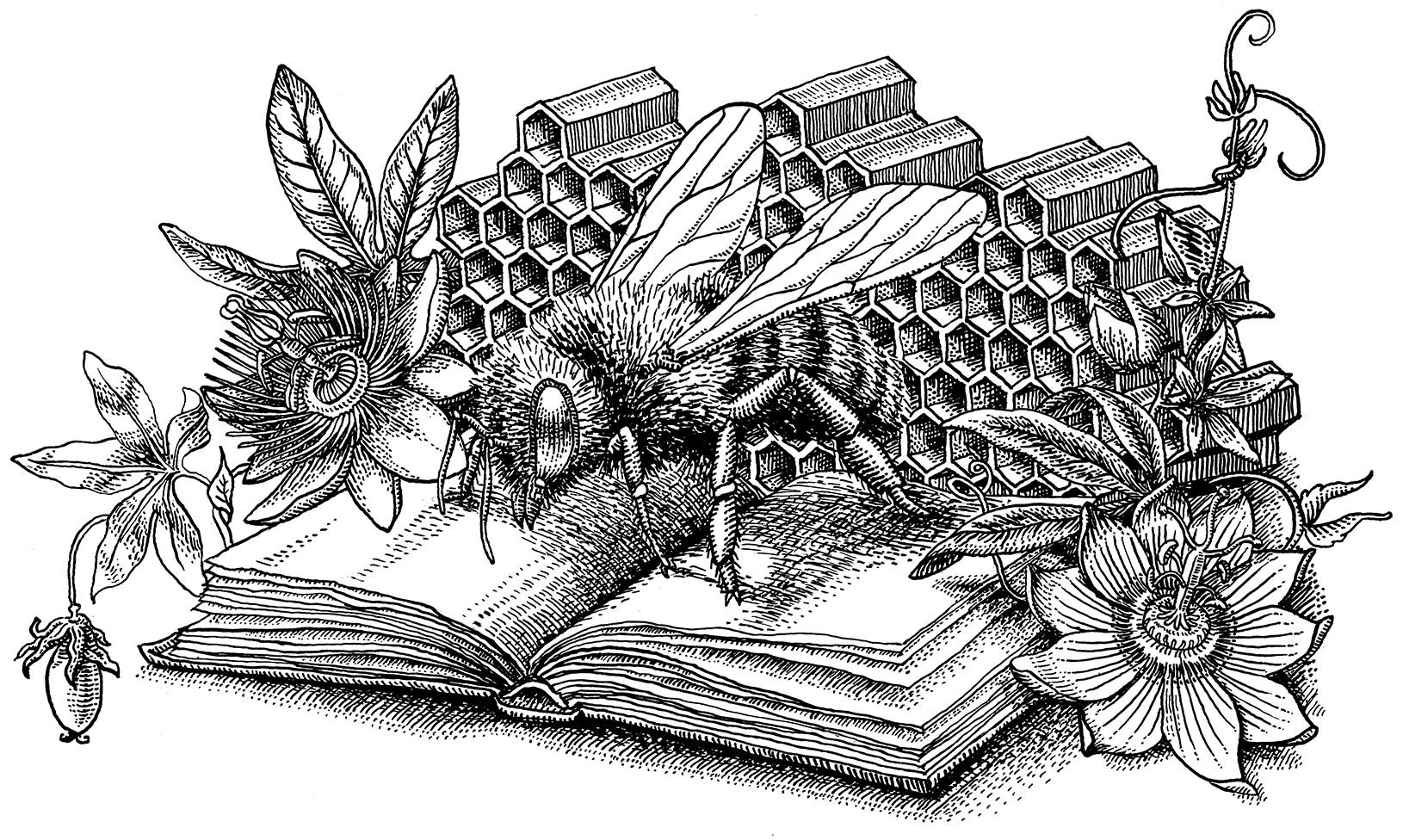
 Même lorsque l’agresseur sexuel reconnaît qu’il a commis les actes qui lui sont reprochés, il met encore une forme de distanciation face aux gestes qu’il a pu faire. Certes, il les a bien commis, certes, dans d’autres contextes cela serait un viol ou une agression sexuelle, mais dans son cas précis, cela n’a strictement rien à voir. On les verra alors parler de « dérapage », « d’humour un peu lourd », de « culture tactile », de « problèmes personnels » ou de « choses qui tournent mal ».
Même lorsque l’agresseur sexuel reconnaît qu’il a commis les actes qui lui sont reprochés, il met encore une forme de distanciation face aux gestes qu’il a pu faire. Certes, il les a bien commis, certes, dans d’autres contextes cela serait un viol ou une agression sexuelle, mais dans son cas précis, cela n’a strictement rien à voir. On les verra alors parler de « dérapage », « d’humour un peu lourd », de « culture tactile », de « problèmes personnels » ou de « choses qui tournent mal ».  Ce sont mes dernières minutes de liberté. Du coin de l’œil, je vois Roussel qui relève la tête. Il va bientôt sonner la fin des hostilités. Il va ajouter que ce n’est pas grave si on n’a pas terminé, qu’on pourra finir à la maison. Ou pas. Que l’important, c’est de se plier aux exigences dans un temps limité, et “de dévider nos pelotes internes”. C’est l’expression qu’il a utilisée la dernière fois. Je l’ai trouvée racoleuse et même malsaine. Ensuite, il va demander qu’on lise à haute voix ce qu’on a produit. Tant pis pour les maladresses, la syntaxe approximative ou les erreurs de grammaire. S’exprimer. On est là pour s’exprimer. Il n’y aura aucun jugement ni aucune correction, puisque ce n’est pas le but. On va faire un tour de table. On arrivera à moi. Et je serai démasqué. Je suis hors sujet. Je ne lirai pas les trois pages que je viens de couvrir. Je me souviens que l’an dernier j’avais cherché sur internet la définition de l’expression “toute honte bue”.
Ce sont mes dernières minutes de liberté. Du coin de l’œil, je vois Roussel qui relève la tête. Il va bientôt sonner la fin des hostilités. Il va ajouter que ce n’est pas grave si on n’a pas terminé, qu’on pourra finir à la maison. Ou pas. Que l’important, c’est de se plier aux exigences dans un temps limité, et “de dévider nos pelotes internes”. C’est l’expression qu’il a utilisée la dernière fois. Je l’ai trouvée racoleuse et même malsaine. Ensuite, il va demander qu’on lise à haute voix ce qu’on a produit. Tant pis pour les maladresses, la syntaxe approximative ou les erreurs de grammaire. S’exprimer. On est là pour s’exprimer. Il n’y aura aucun jugement ni aucune correction, puisque ce n’est pas le but. On va faire un tour de table. On arrivera à moi. Et je serai démasqué. Je suis hors sujet. Je ne lirai pas les trois pages que je viens de couvrir. Je me souviens que l’an dernier j’avais cherché sur internet la définition de l’expression “toute honte bue”.  Quelqu’un, quelque part, disait de faire attention au fil.
Quelqu’un, quelque part, disait de faire attention au fil. 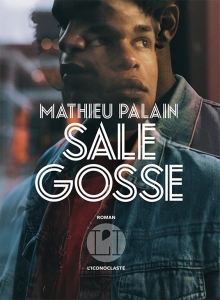 – Quand je suis arrivé à la PJJ, je voulais changer le monde. Aujourd’hui, j’essaye de ne pas l’abîmer. Ton métier, c’est semer sans jamais récolter. Tu suis des mêmes qui disparaissent dans la nature, d’autres les remplacent et tu dois te remettre à semer. Ce n’est pas pour les pragmatiques qui veulent des résultats.
– Quand je suis arrivé à la PJJ, je voulais changer le monde. Aujourd’hui, j’essaye de ne pas l’abîmer. Ton métier, c’est semer sans jamais récolter. Tu suis des mêmes qui disparaissent dans la nature, d’autres les remplacent et tu dois te remettre à semer. Ce n’est pas pour les pragmatiques qui veulent des résultats. 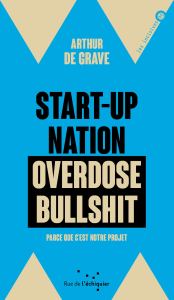 Est-ce à dire qu’il n’y a rien à apprendre de toutes ces belles success-stories ? Non, bien sûr. Mais à condition de ne pas tout mélanger… Par exemple, quand j’entends un quelconque ministre de l’Économie s’extasier sur ces start-up qui créeront demain de l’emploi en masse, j’ai envie de me resservir deux fois des nouilles. Parce que, mon bon ami, pour revenir à une situation de plein-emploi avec les start-up comme pierre angulaire de ta stratégie, il va falloir te lever très, mais alors très tôt. Le but d’une start-up, ce n’est pas de « créer des emplois », n’en déplaise à la novlangue lénifiante que tu aimes tant à employer. C’est même tout le contraire ! Le but d’une start-up, c’est l’hypercroissance, c’est de scaler : faire exploser son volume d’affaires en maintenant les coûts au plus bas pour assurer à terme un très haut niveau de rentabilité. Je ne dis pas que c’est bien ou mal, mais qu’une start-up, par définition, c’est ça. C’est un effet de structure. On n’y peut rien : créer des emplois stables et bien payés en masse, cela entre en contradiction directe avec cet impératif de « scalabilité » (le terme est barbare, je sais, mais c’est la lingua franca de la Start-up Nation, je n’y peux rien).
Est-ce à dire qu’il n’y a rien à apprendre de toutes ces belles success-stories ? Non, bien sûr. Mais à condition de ne pas tout mélanger… Par exemple, quand j’entends un quelconque ministre de l’Économie s’extasier sur ces start-up qui créeront demain de l’emploi en masse, j’ai envie de me resservir deux fois des nouilles. Parce que, mon bon ami, pour revenir à une situation de plein-emploi avec les start-up comme pierre angulaire de ta stratégie, il va falloir te lever très, mais alors très tôt. Le but d’une start-up, ce n’est pas de « créer des emplois », n’en déplaise à la novlangue lénifiante que tu aimes tant à employer. C’est même tout le contraire ! Le but d’une start-up, c’est l’hypercroissance, c’est de scaler : faire exploser son volume d’affaires en maintenant les coûts au plus bas pour assurer à terme un très haut niveau de rentabilité. Je ne dis pas que c’est bien ou mal, mais qu’une start-up, par définition, c’est ça. C’est un effet de structure. On n’y peut rien : créer des emplois stables et bien payés en masse, cela entre en contradiction directe avec cet impératif de « scalabilité » (le terme est barbare, je sais, mais c’est la lingua franca de la Start-up Nation, je n’y peux rien). 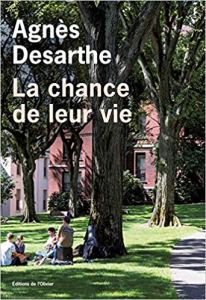 Hector s’est chargé de tout. Il a plié de nouveau tous les pulls que Sophie avait pliés, mais al/ Sans remarques désagréables, sans se moquer ni se plaindre. Sylvie l’a regardé faire, reconnaissante, tout en ayant l’impression qu’on lui sciait doucement les poignets. Les jours s’empilent. Pourtant le quotidien semble ne pas se construire ; l’habitude et sa prodigieuse force d’inertie sont absentes. Certains matins, Sylvie se demande si elle existe encore et, juste après, ce que cela signifie d’exister. Elle sent alors, sous ses pas, le rebord d’une spirale d’anxiété. Si elle avance sur cette voie, elle sera fichue. Elle glissera, perdra ses moyens, ne saura plus remonter. Cela lui est arrivé autrefois. Elle se rappelle la sensation. Un anéantissement auquel on assiste en spectateur, jusqu’au moment où l’on se rend compte que l’on est soi-même démoli. On est alors saisi par l’effroi et l’envie de fuir, sauf que l’on n’a plus l’énergie nécessaire pour s’échapper, faire marche arrière. L’énergie, elle aussi a été détruite, absorbée. Mais c’est très différent à présent. Elle est simplement dépaysée. Hector lui parle de repères. Il lui conseille de prendre ses marques, de s’inventer une routine et, assez rapidement, tout s’améliore. Lester se rend au collège avec le bus jaune. Il est plein de vigueur. Il semble avoir grandi d’un ou deux centimètres. Sylvie a étudié les brochures rapportées quelques semaines plus tôt de l’Alliance française. Cours de danse, de tai-chi, de langues, soirées lecture, spectacles pour enfants, semaine gastronomique. Combien de temps vont-ils rester ? Cela vaut-il la peine qu’elle s’inscrive à toutes ces activités ? N’en choisir qu’une. Atelier de poterie, le mardi et le jeudi. Hector la félicite. Il lui confirme que l’important, c’est de structurer sa semaine.
Hector s’est chargé de tout. Il a plié de nouveau tous les pulls que Sophie avait pliés, mais al/ Sans remarques désagréables, sans se moquer ni se plaindre. Sylvie l’a regardé faire, reconnaissante, tout en ayant l’impression qu’on lui sciait doucement les poignets. Les jours s’empilent. Pourtant le quotidien semble ne pas se construire ; l’habitude et sa prodigieuse force d’inertie sont absentes. Certains matins, Sylvie se demande si elle existe encore et, juste après, ce que cela signifie d’exister. Elle sent alors, sous ses pas, le rebord d’une spirale d’anxiété. Si elle avance sur cette voie, elle sera fichue. Elle glissera, perdra ses moyens, ne saura plus remonter. Cela lui est arrivé autrefois. Elle se rappelle la sensation. Un anéantissement auquel on assiste en spectateur, jusqu’au moment où l’on se rend compte que l’on est soi-même démoli. On est alors saisi par l’effroi et l’envie de fuir, sauf que l’on n’a plus l’énergie nécessaire pour s’échapper, faire marche arrière. L’énergie, elle aussi a été détruite, absorbée. Mais c’est très différent à présent. Elle est simplement dépaysée. Hector lui parle de repères. Il lui conseille de prendre ses marques, de s’inventer une routine et, assez rapidement, tout s’améliore. Lester se rend au collège avec le bus jaune. Il est plein de vigueur. Il semble avoir grandi d’un ou deux centimètres. Sylvie a étudié les brochures rapportées quelques semaines plus tôt de l’Alliance française. Cours de danse, de tai-chi, de langues, soirées lecture, spectacles pour enfants, semaine gastronomique. Combien de temps vont-ils rester ? Cela vaut-il la peine qu’elle s’inscrive à toutes ces activités ? N’en choisir qu’une. Atelier de poterie, le mardi et le jeudi. Hector la félicite. Il lui confirme que l’important, c’est de structurer sa semaine.  Je n’ai jamais été amoureux d’Abigaïl Stenson. La fascination qu’elle exerçait sur moi était d’un autre ordre. Peut-être que j’aurais aimé lui ressembler, peut-être qu’elle incarnait tout ce qu’on m’avait appris à détester. Je ne sais toujours pas exactement.
Je n’ai jamais été amoureux d’Abigaïl Stenson. La fascination qu’elle exerçait sur moi était d’un autre ordre. Peut-être que j’aurais aimé lui ressembler, peut-être qu’elle incarnait tout ce qu’on m’avait appris à détester. Je ne sais toujours pas exactement.  Ainsi, aujourd’hui encore, les noms des grandes figures ayant contribué à sortir les femmes de leur condition subalterne restent inconnus du grand public. Olympe de Gouges a peut-être passé le mur du silence, Simone de Beauvoir a réussi à s’imposer dans les mémoires, mais Jeanne Deroin, Hubertine Auclert, Madeleine Pelletier, et tant d’autres, restent en marge de notre connaissance. Elles ont bravé la bienséance, souvent en subissant la vindicte des puissants, parfois au risque de leur vie. Ce n’est pas un hasard si plusieurs d’entre elles ont fini leurs jours dans un asile psychiatrique, comme Théroigne de Méricourt sous la Révolution française, après avoir été fouettée en place publique pour avoir incité des femmes à organiser un corps d’armée, ou Madeleine Pelletier, qui fut arrêtée en 1939 pour avoir pratiqué des avortements en toute illégalité. Elles ont souvent été dépeintes comme des « hystériques », « excessives », « mal baisées », et que sais-je encore. Le regard social sur elles n’est pas tendre. Dans le langage courant, « suffragettes » ou « MLF » ne sont pas des épithètes sympathiques. Le mépris, l’oubli ou la caricature prévalent. Et pourtant… Nous leur devons les écoles mixtes et les centres IVG. Nous leur devons la possibilité de déposer un bulletin dans l’urne ou une plainte au commissariat pour un viol. Nous leur devons le divorce et la fin des corsets. Aux féministes et à leurs ancêtres, la République pourrait être reconnaissante.
Ainsi, aujourd’hui encore, les noms des grandes figures ayant contribué à sortir les femmes de leur condition subalterne restent inconnus du grand public. Olympe de Gouges a peut-être passé le mur du silence, Simone de Beauvoir a réussi à s’imposer dans les mémoires, mais Jeanne Deroin, Hubertine Auclert, Madeleine Pelletier, et tant d’autres, restent en marge de notre connaissance. Elles ont bravé la bienséance, souvent en subissant la vindicte des puissants, parfois au risque de leur vie. Ce n’est pas un hasard si plusieurs d’entre elles ont fini leurs jours dans un asile psychiatrique, comme Théroigne de Méricourt sous la Révolution française, après avoir été fouettée en place publique pour avoir incité des femmes à organiser un corps d’armée, ou Madeleine Pelletier, qui fut arrêtée en 1939 pour avoir pratiqué des avortements en toute illégalité. Elles ont souvent été dépeintes comme des « hystériques », « excessives », « mal baisées », et que sais-je encore. Le regard social sur elles n’est pas tendre. Dans le langage courant, « suffragettes » ou « MLF » ne sont pas des épithètes sympathiques. Le mépris, l’oubli ou la caricature prévalent. Et pourtant… Nous leur devons les écoles mixtes et les centres IVG. Nous leur devons la possibilité de déposer un bulletin dans l’urne ou une plainte au commissariat pour un viol. Nous leur devons le divorce et la fin des corsets. Aux féministes et à leurs ancêtres, la République pourrait être reconnaissante.  – Dès que tu ouvres la bouche, tu t’éloignes de moi, m’a-t-il balancé.
– Dès que tu ouvres la bouche, tu t’éloignes de moi, m’a-t-il balancé.